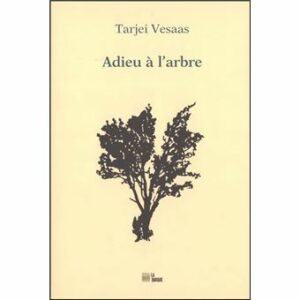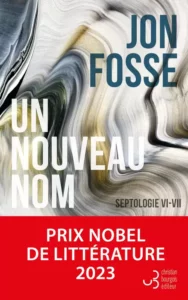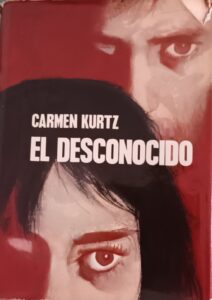… Cette couverture jaunie, cette odeur de moisi, cet ex-libris pompeux…
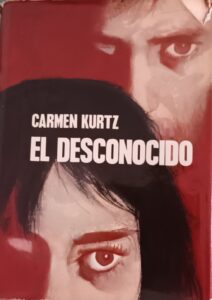
Sortons des contours pour entrer dans le roman publié en 1956. Les deux protagonistes Antonio et Dominica – dont les deux points de vue alternent dans le roman – sont des époux qui se retrouvent après une séparation de douze ans due à la captivité lointaine d’Antonio pendant la guerre.
La critique loue unanimement la finesse psychologique de l’autrice qui présente deux êtres que la vie a séparés et qui tentent de renouer leurs liens : complexité émotionnelle, difficulté du retour à la vie normale pour un homme traumatisé par de mauvais traitements, difficulté de l’accueil pour une femme restée tant d’années sans nouvelles de son mari. Les comparaisons avec le retour d’Ulysse à Ithaque sont récurrentes. L’écriture est précise, fine, sensible. Discrète, aussi, parce qu’« il y a des choses qui ne se comprennent pas. »
Et il y a des choses dont on ne parle pas. Au fur et à mesure de ma lecture, j’ai éprouvé le sentiment de plus en plus insistant d’un lourd non-dit provenant d’une censure ou d’une auto-censure. Comme s’il y avait des zones grises dans une narration où rien n’était faux, mais où rien n’était tout à fait vrai non plus. Ou plus exactement : comme si la situation émotionnelle était juste, mais ses causes historiques à la fois précises et gommées. Et ceci m’a mise mal à l’aise.

Vaisseau Sémiramis, photo Arxiu tve Catalunya
Non, ce roman ne donne pas une version intemporelle du retour d’Ulysse. Il se situe à Barcelone en 1954. Antonio, le mari, arrive à bord du Sémiramis, vaisseau par lequel sont rapatriés les anciens de la División Azul dont il faisait partie, retenus dans un camp en URSS pendant douze ans. La División Azul fut créée en 1941 par Franco avec des volontaires qui se mettaient à la disposition de la Wehrmacht pour combattre sur le front de l’Est, et qui devaient jurer devant Dieu obéissance à Hitler dans sa lutte contre le bolchevisme. ♠
Antonio, décrit par son épouse comme un jeune homme d’une fougue extraordinaire, éperdument amoureux d’elle, s’est engagé avec enthousiasme en Allemagne en 1941 sans en dire un mot à sa femme qui ne s’en plaint nullement, et sans remettre en cause par la suite son engagement.
Pourquoi diable l’autrice dont le mari a été prisonnier des Allemands a-t-elle placé son héros dans cette galère franquiste ? Quelqu’un a-t-il mis la main au manuscrit pour le dénaturer ? Est-ce moi qui n’ai pas, depuis la France, toutes les données pour saisir la subtilité de certaines nuances ? Je sais que peu de temps après Carmen Kurtz a renoncé à l’écriture de romans pour se consacrer à la littérature jeunesse.

Dernière question : l’adaptation théâtrale de Yolanda Pallín qui se donne en ce moment à Madrid tient-elle compte de ces circonstances d’écriture ? Il semblerait d’un côté que la pièce cherche à aborder, « au-delà du moment historique concret, des thèmes universels », dit la metteuse en scène Laura Garmo qui se réfère à son tour à Ulysse et Pénélope. Mais, ajoute-t-elle, le non-dit du roman est prononcé à voix haute sur scène comme une sous-conversation ambiguë et chargée de sens.
Alors ?
Je crois que je vais lancer une question à mes amis madrilènes susceptibles d’avoir vu cette pièce, à l’affiche jusqu’au 23 décembre au Teatro Español à Madrid.

Le Teatro espanol, plaza Santa Ana, Madrid
♠ Pour des informations précises sur cette division, voir la fiche Wikipedia, très bien documentée. Sa traduction en français : https://fr.wikipedia.org/wiki/Division_Bleue_(Seconde_Guerre_mondiale)